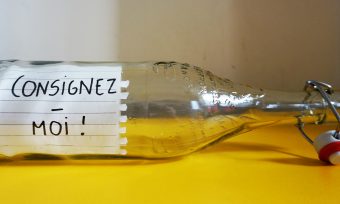Comment faire entendre sa voix en tant que citoyen·ne ? Les outils prévus par le droit français
Plusieurs outils d’information et de participation citoyenne existent en droit français, afin de permettre à chacun·e de donner son avis sur la réglementation en cours de construction ou sur des projets industriels.
Les grands principes de la réglementation en matière de participation citoyenne
Les grands principes du droit d’accès aux informations environnementales, de participation du public et d’accès à la justice environnementale ont été consacrés par la Convention internationale d’Aarhus : signée en juin 1998 par 47 États, cette convention a été développée dans un contexte de prise de conscience suite à des catastrophes écologiques telles que les marées noires ou Tchernobyl.
Afin de répondre aux exigences de la convention puis des textes européens qui en découlent, la loi française s’est adaptée notamment à travers la Charte de l’environnement en 2004, à valeur constitutionnelle donc au sommet du droit français.
L’article 7 de cette Charte consacre que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement »
Le droit d’accès aux informations environnementales est également consacré dans le droit français par le biais de la réglementation dite “CADA” (Commission d’accès aux documents administratifs). Ainsi, tout·e citoyen·ne a le droit de demander la communication de toutes informations et tous documents qui concernent l’environnement, à toute autorité publique ou entreprise chargée d’un service public en lien avec l’environnement. Ce droit est soumis à plusieurs limites, notamment la protection du secret des affaires, qui peut représenter un frein considérable à la bonne information du public.
Une limite au respect des principes de la Convention d’Aarhus
Malheureusement, le respect des droits consacrés par la Convention n’est pas encore pleinement assuré. En effet, la question de l’accès à la justice environnementale par les citoyen·nes pose problème au sein de l’Union Européenne. Certains pays, dont la France, se positionnent contre l’élargissement des prérogatives des citoyen·nes des Etats membres de l’Union européenne et des ONG pour contester les décisions européennes, et notamment celles de la Commission Européenne (l’organe qui produit justement le plus grand volume de législation environnementale dans toute l’Union Européenne).
Malgré une certaine réticence des Etats, le public est invité à participer à la prise de décision en matière environnementale au sein des pays qui ont ratifié la convention. En France, plusieurs outils sont mis à sa disposition afin de lui donner l’occasion de faire entendre sa voix.
Une consultation du public obligatoire dans la construction de la réglementation
De manière générale, le public a le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement, tout en bénéficiant de délais suffisants pour déposer une contribution. Il est également en droit de connaître de quelle manière ses recommandations sont prises en compte.
Les outils mis en place pour favoriser la participation du public, dont la consultation fait partie intégrante, sont d’autant plus importants que de nombreuses lois environnementales ont des incidences sur le quotidien des citoyen·nes. C’est le cas par exemple de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) de 2020, qui prévoit notamment la fin progressive de plusieurs objets ou emballages en plastique à usage unique, et a donc un impact direct sur les modes de consommation individuels.
Les citoyen·nes peuvent ainsi être consulté·es aussi bien en amont de l’élaboration d’un projet de loi qu’en aval, lors de la rédaction de ses différents décrets d’application. Dans le cas de la loi AGEC, le public a été associé dès 2018 via la feuille de route économie circulaire, afin de donner son avis sur plusieurs propositions. La participation a été relativement importante, avec un total de 1 800 contributions citoyennes.
Une fois la loi votée par les parlementaires, vient le temps de son application à travers divers textes réglementaires préparés par le Gouvernement et son administration. Chacun de ces textes, lorsqu’il est susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement, est également soumis à consultation du public. Cette consultation permet aux citoyen·nes de peser et de renforcer le discours des associations qu’ils et elles soutiennent, là où les acteurs industriels et économiques ont souvent l’occasion de faire valoir leurs arguments à chaque étape de la fabrique de la réglementation. C’est d’autant plus important que ces textes pourront avoir un impact direct sur le quotidien de chacun·e. Ainsi, un article de la loi AGEC prévoyait que les fruits et légumes seraient désormais vendus en vrac dans les grandes et moyennes surfaces à partir de 2022, sauf exceptions précisées par décret. Le public a pu donner son avis sur cette liste d’exemptions à travers le portail de consultation publique prévu à cet effet – Zero Waste France a également contribué en tant qu’association environnementale.
Exemple de contribution d’un citoyen
En tant que citoyen, j’ai du mal à comprendre la longueur de cette liste d’exemptions qui couvre au final la majorité des références disponibles chez le primeur. La quasi intégralité des fruits et légumes indiqués dans ce décret sont aujourd’hui vendus sans conditionnement dans la plupart des magasins sans que cela ne pose de problème. Pourquoi décider de généraliser ce bannissement du plastique sur les fruits et légumes dans la loi AGEC pour en même temps en empêcher son application via ce décret ? Tous les fruits et légumes aujourd’hui vendus sans conditionnement plastique dans les commerces (donc quasiment tous : tomates, pêches, abricots, cerises, haricots verts, navets, oignons et pommes de terre primeurs, brocolis, salades, épinards…) devraient être de facto exclus de ce décret, car ils sont bien la preuve que c’est possible.
Exemple de contribution de Zero Waste France
L’article 77 de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire dispose que les fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac sont exemptés de l’obligation d’exposition sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique dans les commerces de vente au détail. Dans cette perspective, on pourrait légitimement s’attendre à une liste limitative d’exemptions ; en effet, l’existence de la vente sans emballage plastique en grande distribution pour un produit justifie la possibilité de le commercialiser sans conditionnement plastique tout en le préservant de la détérioration.
Aussi, Zero Waste France s’étonne de la liste proposée à date dans le décret, qui affranchit de l’obligation un certain nombre de fruits et légumes pourtant d’ores et déjà présentés en vrac en grandes surfaces. Alors que près des trois quarts des pêches, nectarines et abricots, la moitié des asperges, ou encore le tiers des choux de Bruxelles ou des champignons commercialisés en grande distribution à date le sont en vrac, il est difficile de comprendre ce qui justifie une exemption de l’obligation d’exposition de ces fruits et légumes sans conditionnement plastique à échéance 2022. Globalement, le projet de décret semble actuellement bien trop permissif. Des exemptions se justifieraient par exemple pour les petits calibres de carottes primeurs et les petites carottes, actuellement non exposées en vrac. De même il pourrait être envisageable d’exempter jusqu’en 2023 la mâche, les jeunes pousses, les herbes aromatiques, les épinards, l’oseille, les fleurs comestibles et les pousses de haricot mungo, et jusqu’en 2025 les graines germées, les fraises, les framboises, les groseilles, les myrtilles, les mûres et les les kiwaïs. En ce qui concerne les autres fruits et légumes mentionnés dans le projet de décret, une exemption de l’obligation de présentation sans conditionnement plastique n’apparaît pas justifiée.
Pour ce qui est de la définition des « fruits et légumes frais non transformés », Zero Waste France est alignée avec ce qui figure dans le projet de décret, la préparation d’un fruit ou légume ne constituant pas une transformation.
Il est possible de retrouver les consultations en cours sur la plateforme des consultations publiques du ministère de la Transition écologique.
Les projets industriels : également soumis à la participation du public
Le public peut également donner son avis sur des projets industriels ayant une incidence sur l’environnement, tels que les projets d’incinérateurs ou de méthanisation. D’ailleurs, la prise en compte des contributions citoyennes formulées au terme d’un débat public ou d’une concertation préalable – en amont de la demande d’autorisation du projet – fait partie intégrante du processus d’évaluation environnementale, étape nécessaire à l’autorisation d’un projet par l’Etat.
En plus de cette concertation en amont, le code de l’environnement impose également une participation du public après la demande d’autorisation et avant le début des travaux, qui, pour les projets les plus importants, prend la forme d’une enquête publique. Les contributions citoyennes déposées dans le cadre d’une enquête publique doivent être rassemblées et analysées par un·e commissaire enquêteur·trice neutre, qui dresse à la fin de l’enquête un rapport censé influer sur la décision finale de l’autorité publique compétente pour autoriser le projet.
Ainsi, la place réservée à la participation citoyenne est importante dans l’élaboration d’un projet, même s’il est à déplorer que les observations du public ne soient pas toujours prises en compte.
En tant qu’ONG environnementale, Zero Waste France dépose des contributions dans le cadre des enquêtes publiques sur les projets d’installations de traitement des déchets, pour attirer l’attention par exemple sur le surdimensionnement d’un projet d’incinérateur ou encore sur l’insuffisance de l’évaluation des impacts environnementaux du projet. Il est primordial que les citoyen·nes du territoire d’implantation du projet fassent aussi entendre leur voix, pour envoyer un signal fort aux pouvoirs publics et pouvoir faire pencher la balance en faveur de la protection de l’environnement.
A ce jour, ces outils de participation citoyenne restent peu utilisés, car souvent méconnus ; n’hésitez pas à vous en saisir ! Outre la contribution individuelle en tant que citoyen·ne dans le cadre des processus prévus par la loi, il est également possible d’adhérer à une association de protection de l’environnement, qui rassemble les voix des citoyen·nes afin d’avoir plus de poids dans le cadre des procédures de participation du public sur les sujets environnementaux.