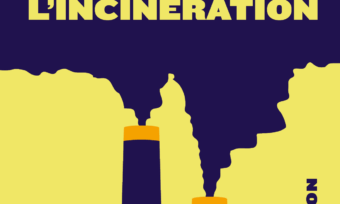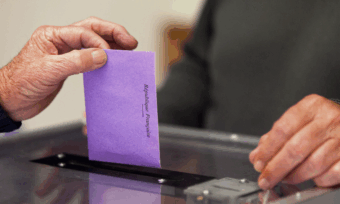L’incinération des déchets ménagers : un pari coûteux
Alors que la réduction des déchets à la source devrait être la priorité des politiques publiques, l’incinération reste aujourd’hui une solution surinvestie et largement subventionnée.
Derrière les discours de valorisation énergétique se cachent des coûts faramineux, un modèle rigide pour les collectivités locales et un frein aux alternatives durables comme le réemploi, le compostage ou le recyclage. En France, ce sont près de 30 % des déchets ménagers et assimilés qui sont encore brûlés [1]. Pourtant, les chiffres sont sans appel : l’incinération est l’un des moyens les plus chers, les moins créateurs d’emplois, et les plus polluants pour traiter nos déchets.
Un coût direct exorbitant
En 2021, le service public de gestion des déchets (SPGD) a coûté 12,7 milliards d’euros. En vingt ans, la dépense intérieure de gestion des déchets a plus que doublé. Une part significative de cette dépense est liée à l’incinération : en 2020, elle a représenté 1,7 milliard d’euros pour environ 14,5 millions de tonnes incinérées. Cela équivaut à un coût moyen de 116 € par tonne. Même après prise en compte des produits et aides issus de l’incinération, les collectivités locales continuent de payer 105 € par tonne : un montant élevé, surtout comparé à des alternatives comme la collecte séparée des biodéchets (21 €/an/hab.[2]) ou le compostage collectif (9,50 €/an/hab.[3]).
Ces coûts s’expliquent notamment par les investissements colossaux nécessaires à la construction et à l’entretien des incinérateurs. Entre les investissements initiaux (coût prévisionnel de l’ordre de 450 millions d’euros [4] pour l’incinérateur de Toulouse, par exemple), les mises aux normes, les opérations de modernisation et de valorisation énergétique, les collectivités engagent des sommes considérables. À Toulouse, 19,6 millions d’euros ont été consacrés à l’incinération en 2020, soit 28 fois plus que le budget dédié à la prévention des déchets.
Des financements publics orientés dans la mauvaise direction
L’incinération est massivement financée par l’argent public, à travers :
- Les taxes ou redevances d’ordures ménagères (TEOM / REOM) payées par les habitants ;
- Des subventions publiques, notamment via l’ADEME, à travers :
- Le Fonds Chaleur, qui a injecté 25 millions d’euros en 2023 pour des projets de récupération de chaleur, incluant les incinérateurs (ce qui n’est plus autorisé depuis 2024, sauf pour les réseaux de chaleur).
- Le Fonds Économie circulaire, doté de 300 millions d’euros en 2024, mais qui sera réduit à 170 millions en 2025. Il a financé 263 millions d’euros pour 19 chaufferies CSR (Combustibles Solides de Récupération).
Ce mode de traitement bénéficie en outre d’incitations financières : les incinérateurs à haut rendement énergétique bénéficient d’une réduction de TGAP (taxe générale sur les activités polluantes), tandis que les chaufferies CSR en sont totalement exonérées. Cela revient, de fait, à subventionner un système polluant, au détriment de solutions réellement durables. La TVA réduite à 5,5 % pour la chaleur provenant de l’incinération vient compléter cette série d’avantages fiscaux, comme s’il s’agissait d’une énergie renouvelable.
Un système verrouillé, limitant toute politique de réduction des déchets
Chaque nouvel incinérateur est conçu pour une durée de vie de 40 à 50 ans. Son amortissement financier sur le temps long repose donc sur un approvisionnement régulier en déchets, pendant de nombreuses années. Ce besoin structurel entre en contradiction directe avec les politiques de réduction, de tri et de recyclage. Plus inquiétant encore, cette dépendance peut freiner ou dissuader les collectivités d’investir dans des solutions circulaires moins polluantes.
L’exemple du projet de modernisation de l’incinérateur de Taden (125 millions d’euros pour augmenter la capacité de 106 400 à 150 000 tonnes/an) illustre cette tendance à surdimensionner les infrastructures. Ces mégastructures risquent de se retrouver rapidement en surcapacité… ou de devoir importer des déchets, comme c’est déjà le cas à Copenhague, où un incinérateur flambant neuf doit importer depuis l’étranger 110 000 tonnes de déchets par an pour fonctionner à plein régime.
L’Union européenne, dans sa directive de 2018, place l’incinération et l’enfouissement au même rang dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets : des solutions de dernier recours, à n’utiliser qu’après avoir tout tenté pour prévenir, réemployer, recycler. Pourtant, en France, la priorité reste donnée à l’incinération.
L’ADEME indique qu’en 2022 [5], les collectivités ont consacré :
- 1 % de leur budget déchets à la prévention,
- 1 % à la communication,
- 39 % au traitement.
Autrement dit, la France consacre très peu de moyens aux actions pourtant les plus efficaces sur le long terme.
Des coûts cachés majeurs : santé, environnement, climat
Au-delà des coûts budgétaires visibles, l’incinération engendre des coûts externes majeurs. L’Agence européenne pour l’environnement (AEE) [6] a travaillé en 2021 sur une estimation des dommages sanitaires et environnementaux des émissions industrielles. A partir de ces travaux, on peut estimer ces dommages pour la France entre 18 et 29 milliards d’euros. Pour l’incinération seule, ce coût représenterait entre 2,5 et 3 milliards d’euros — bien supérieur aux 1,7 milliard d’euros dépensés officiellement par les collectivités.
À Toulouse, le groupe local Zero Waste Toulouse a évalué les coûts sanitaires et environnementaux de l’incinérateur entre 37 à 56 millions d’euros pour la seule année 2021 [7], en tenant compte des impacts des émissions de CO₂, NOx, SO₂, particules fines et dioxines sur la santé humaine et l’environnement.
Une énergie chère, inefficace et peu créatrice d’emplois
Contrairement à l’image parfois véhiculée, l’énergie issue de l’incinération est loin d’être compétitive. Le coût moyen mondial de production d’un mégawattheure via l’incinération est de 140 dollars [8], contre moins de 50 dollars pour l’éolien ou le solaire. Par ailleurs, ce procédé est l’un des moins créateurs d’emplois du secteur déchets [9] :
- 1,7 emploi pour 10 000 tonnes traitées/an, contre :
- 7 à 15 emplois pour le compostage
- 55 emplois pour l’utilisation de matériaux recyclés
- 115 emplois pour le recyclage
404 emplois pour la réparation
Autrement dit, pour chaque euro investi dans l’incinération, on sacrifie un potentiel énorme de création d’emplois locaux, durables et qualifiés.
Des alternatives bien connues : financer la prévention
Des alternatives concrètes, économiques et durables existent. Selon l’ONG GAIA [10], avec un budget équivalent à la construction d’un incinérateur (1,2 milliard de dollars), on pourrait :
- construire 3 sites de compostage (1 million de tonnes/an chacun) ;
- construire 8 installations de récupération de matériaux ;
- financer la collecte séparée des biodéchets d’une ville comme Melbourne pendant 1 200 ans ;
- créer entre 12 et 24 centres de réemploi ;
- équiper 12 000 déchèteries avec des espaces de réemploi.
Ces alternatives ont un coût moindre à la tonne, sont bien plus créatrices d’emplois, et s’alignent avec les objectifs environnementaux et climatiques de la France et de l’Union européenne.
Changer de paradigme avant qu’il ne soit trop tard
L’incinération, en dépit de ses apparentes vertus de “valorisation énergétique”, constitue un verrou technologique, économique et politique. Elle entretient un système de surproduction de déchets, capte des fonds publics qui devraient être dirigés vers des solutions de réduction et de réemploi, et impose aux collectivités un modèle rigide pour plusieurs décennies.
Pour engager une véritable transition écologique et sociale, il est essentiel d’investir massivement dans la prévention et la sensibilisation à la réduction des déchets, tout en renforçant les moyens alloués aux collectivités, notamment par le maintien et l’augmentation du fonds vert. Il convient également d’orienter davantage de financements vers le réemploi et la réparation au sein de la REP, de réserver l’intégralité de la TGAP à des actions de prévention, et d’appliquer cette taxe sans dérogation à toutes les installations d’incinération, y compris celles à haut rendement ou utilisant des CSR.
Dans cette logique, nous demandons l’arrêt immédiat de tout nouveau projet d’unité d’incinération ou d’extension de capacité, conformément aux recommandations du CESE et aux objectifs de réduction fixés par la loi. Il est également indispensable de planifier, à l’échelle nationale et européenne, la réduction progressive des capacités existantes d’incinération, avec une cible de fermeture d’au moins 5 % des installations par an. Cette planification doit être publique, transparente, alignée sur les objectifs légaux de prévention des déchets, et viser à éviter les doublons territoriaux tout en favorisant la mutualisation des unités existantes plutôt que de nouveaux investissements.
[1] ADEME, Le traitement des déchets ménagers et assimilés en 2022, août 2024
[3] Réseau Compost Citoyen
[4] Le Journal des Entreprises, Toulouse se dote d’un nouvel incinérateur à 450 millions d’euros, avril 2025
[5] ADEME, Référentiel des coûts du service public de gestion des déchets, 2022
[6] European Environment Agency, The costs to health and the environment from industrial air pollution in Europe – 2024 update, janvier 2024
[7] Zero Waste Toulouse, Les coûts cachés de l’incinération des déchets
[8] GAIA, The high cost of waste incineration
[9] GAIA, Zero Waste and economic recovery : the job creation potential of zero waste solutions
[10] GAIA, The high cost of waste incineration