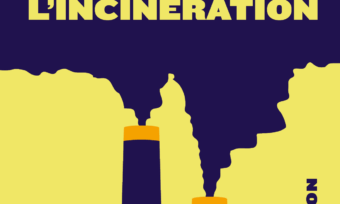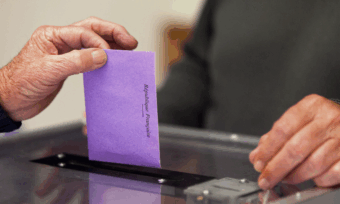Incinération des déchets : une menace persistante pour la santé et l’environnement
Généralement présentée comme une solution hygiénique et maîtrisée de traitement des déchets, l’incinération est depuis longtemps remise en question par les ONG environnementales. En France, plus de 14,05 millions de tonnes d’ordures ménagères sont encore brûlées chaque année dans près de 119 unités d’incinération.
Des polluants invisibles, aux effets bien réels
Le fonctionnement d’une unité d’incinération des ordures ménagères (UIOM) repose sur la combustion à haute température de déchets ménagers et assimilés. Cette combustion libère une variété de polluants car les déchets brûlés contiennent eux-mêmes des composés chimiques ou organiques dangereux (plastiques chlorés, textiles traités, déchets électroniques, etc.). Leur incinération génère donc inévitablement des substances toxiques, classées selon différentes catégories.
Quels polluants dans les fumées d’incinération ?
Malgré les avancées technologiques en matière de filtration et l’application des MTD (meilleures techniques disponibles) [1], les incinérateurs ne parviennent pas à éliminer totalement les polluants qu’ils génèrent. Ces substances, parfois très persistantes, se propagent bien au-delà du périmètre des installations, contaminant les sols, la végétation et exposant durablement les populations riveraines. Si la réglementation encadre théoriquement les émissions et impose certaines obligations de contrôle, les seuils autorisés et les dispositifs de suivi restent largement insuffisants face aux risques réels. En pratique, les incinérateurs continuent ainsi de relâcher un cocktail de composés toxiques dans l’environnement, tels que :
- Dioxines et furanes, issus de la combustion incomplète de matières chlorées, sont cancérogènes, mutagènes et bioaccumulables [2]. Leur toxicité est avérée même à très faibles doses.
- Métaux lourds (plomb, mercure, cadmium, arsenic…) sont neurotoxiques et perturbateurs endocriniens. Ils s’accumulent dans les sols et les organismes vivants.
- Particules fines (PM10, PM2,5), transportent d’autres polluants adsorbés et pénètrent profondément dans l’appareil respiratoire.
- Composés organiques volatils (benzène, formaldéhyde…), dont plusieurs sont classés cancérogènes.
- Oxydes d’azote (NOx), qui participent à la formation de l’ozone troposphérique et aggravent les pathologies respiratoires.
Quels risques pour la santé humaine ?
Les effets sanitaires de l’incinération sont désormais bien documentés. Plusieurs études épidémiologiques [3] ont mis en évidence une augmentation de certaines pathologies graves dans les zones proches d’incinérateurs : cancers, malformations congénitales, troubles de la reproduction, ou encore affections respiratoires, notamment chez les enfants. Ces impacts peuvent survenir même lorsque les émissions sont dites « conformes aux normes ». Cela s’explique par l’« effet cocktail », un phénomène où des substances a priori peu toxiques deviennent dangereuses par interaction, et par la vulnérabilité accrue de certaines catégories de population (femmes enceintes, enfants, personnes âgées). Par ailleurs, des polluants comme les dioxines [4], classés parmi les perturbateurs endocriniens, peuvent provoquer des effets délétères à des doses extrêmement faibles, dès lors qu’il y a exposition chronique. Ce constat met en cause le principe toxicologique selon lequel « la dose fait le poison », aujourd’hui remis en question pour de nombreuses substances issues de l’incinération.
Ces risques ne sont pas répartis équitablement dans la population. L’implantation des incinérateurs suit souvent une logique d’injustice environnementale : ce sont les territoires les plus précaires qui en subissent les nuisances. On parle dans ce contexte de racisme environnemental, un terme issu des luttes écologistes aux États-Unis dans les années 1980, qui désigne le fait que les populations racisées, marginalisées ou à faibles revenus sont les plus exposées aux pollutions. Ce phénomène a été observé aux États-Unis, au Royaume-Uni, et se vérifie également en France. Par exemple, en Île-de-France, les communes d’Ivry-sur-Seine et de Saint-Ouen-sur-Seine, qui accueillent les deux plus gros incinérateurs de la région, figurent parmi les 50 communes les plus pauvres de France [5]. Ces populations, déjà confrontées à des inégalités sociales structurelles, disposent de peu de leviers pour s’opposer à l’installation de telles infrastructures polluantes.
Une situation comparable se retrouve dans l’agglomération de Troyes Champagne Métropole : l’incinérateur local y a été implanté à La Chapelle-Saint-Luc, la commune la plus défavorisée des 81 que compte l’intercommunalité. Cela illustre une nouvelle fois la corrélation persistante entre précarité socio-économique et exposition environnementale, au cœur des dynamiques d’injustice environnementale.
Le cas d’Ivry-Paris XIII
À Ivry-sur-Seine, plusieurs campagnes de biosurveillance ont révélé une contamination inquiétante de l’environnement par des dioxines, des PFAS et des métaux lourds. En 2021, des œufs issus de poulaillers urbains ont montré des niveaux excessifs de dioxines, entraînant une étude plus large conduite en 2023 par l’Agence Régionale de Santé (ARS) [6]. Résultat : des concentrations élevées ont été détectées dans l’air, les œufs et la végétation à l’échelle de la région parisienne.
En 2025, un rapport intermédiaire publié par ToxicoWatch [7] a mis en évidence via une seconde phase d’analyses, menée en 2024-2025 dans les cours d’écoles primaires et les espaces publics, la présence d’une pollution diffuse : mousses, végétation et sols présentent des niveaux préoccupants de dioxines. Une seule école sur sept s’est révélée faiblement contaminée. Même au Jardin des Plantes de Paris, à 2,5 km au nord, les mousses ont révélé la présence de dioxines et de métaux lourds.
Tous les métaux lourds analysés étaient présents à des niveaux élevés, dépassant les seuils alimentaires de sécurité. Ces résultats confirment une exposition chronique des populations locales, en particulier des enfants, et soulignent l’urgence d’une surveillance renforcée autour de cette installation.
PFAS : ces « polluants éternels » que l’incinération contribue à répandre
Des substances omniprésentes, toxiques et très résistantes
Les PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées), aussi appelés « polluants éternels » en raison de leur extrême persistance [8] dans l’environnement et l’organisme, suscitent une attention croissante en raison de leur toxicité avérée. Utilisés pour leurs propriétés hydrofuges, anti-adhésives et résistantes aux hautes températures, on les retrouve dans une multitude de produits du quotidien (poêles, textiles, emballages alimentaires, ustensiles de cuisine, mousses anti-incendie…). Leur dispersion est aujourd’hui massive : ils sont détectés dans l’air, l’eau potable, les sols, les aliments, et jusque dans le sang de la quasi-totalité de la population mondiale.
Le constat est affligeant : les effets sanitaires de ces polluants éternels sont multiples, et peuvent générer perturbations hormonales, affaiblissement du système immunitaire, augmentation du cholestérol, ou encore des risques accrus de certains cancers (notamment du testicule et du rein). Ces substances toxiques peuvent s’accumuler durablement dans l’organisme. Leur « demi-vie » — c’est-à-dire le temps nécessaire pour que la moitié de la substance soit éliminée du corps — peut atteindre plusieurs années [9], ce qui rend leur élimination très difficile et prolonge les effets d’une exposition même ponctuelle.
Incinération : une fausse solution qui disperse au lieu de détruire
Les PFAS, que l’on sait omniprésents dans notre quotidien — textiles, emballages, ustensiles antiadhésifs, etc — se retrouvent, in fine, massivement dans nos ordures ménagères résiduelles, donc dans les flux destinés à l’incinération. Or, contrairement à une idée reçue, ces substances ne sont pas totalement détruites par la combustion. Très résistantes, certaines ne se dégradent qu’à des températures supérieures à 1 300 °C [10]. Cependant, les fours des incinérateurs ne sont pas conçus pour atteindre des températures aussi élevées — supérieures à 1 300 °C — nécessaires à la destruction complète des PFAS les plus persistants. En fonctionnement standard, les températures varient généralement entre 850 et 1 000 °C. Rehausser ce seuil poserait d’importants défis techniques : il faudrait entièrement repenser les infrastructures, au prix d’une consommation énergétique bien plus importante, avec des conséquences en cascade sur les émissions de CO₂, les coûts d’exploitation, et l’usure prématurée des équipements.
Résultat : une partie des PFAS n’est pas détruite lors de l’incinération et se retrouve dans différents rejets de l’installation. Les fumées émises contiennent encore ces substances, même après leur passage dans les systèmes de filtration. Les PFAS peuvent aussi se retrouver dans les eaux de lavage des fumées, un liquide utilisé pour capturer les polluants présents dans les gaz. Or, si ces eaux ne sont pas efficacement traitées par les stations d’épuration classiques, elles peuvent contaminer les milieux aquatiques.
Les mâchefers [11], résidus solides issus de la combustion des déchets, contiennent eux aussi des PFAS. Ces derniers sont fréquemment utilisés pour construire des routes (en sous-couche routière), ce qui peut entraîner une infiltration lente et continue des polluants vers les nappes phréatiques, qui alimentent les populations en eau potable.
Quant aux résidus d’épuration des fumées d’incinération des ordures ménagères (REFIOM), ils concentrent les polluants piégés dans les filtres, dont les PFAS. La France en produit environ 400 000 tonnes par an. Ces déchets, très toxiques, doivent en théorie être stabilisés (traités pour éviter leur dispersion) et confinés dans des installations spécialisées pour déchets dangereux. Mais en pratique, une part importante est exportée, notamment en Allemagne, où elle est stockée dans d’anciennes mines de sel — une forme d’enfouissement dont les conséquences à long terme restent incertaines.
En France, le manque de lieux adaptés pour gérer ces déchets pousse à l’agrandissement de sites de stockage, souvent situés à proximité de zones habitées, ce qui suscite de fortes inquiétudes locales. Ironie du système : plus les technologies de filtration des incinérateurs deviennent efficaces, plus elles produisent de déchets hautement polluants à gérer : un transfert de pollution non résolu, révélateur des impasses structurelles de l’incinération à grande échelle.
Une réponse réglementaire trop lente
Malgré l’accumulation des données scientifiques, les réponses réglementaires [12] restent parcellaires et souvent entravées par les intérêts industriels (fruit d’un lobbying effréné mené par plusieurs acteurs tels que le groupe SEB, propriétaire de la célèbre marque Tefal [13]).
- Le règlement européen sur les emballages (PPWR) prévoit une interdiction des PFAS dans les emballages à partir de 2026.
- En France, la loi du 27 février 2025 interdit certains usages (textiles, cosmétiques…), mais laisse de côté des produits stratégiques comme les ustensiles de cuisine, en raison du lobbying de certaines entreprises.
- L’arrêté ministériel du 10 novembre 2024 introduit le suivi de 49 composés PFAS dans les fumées d’incinérateurs, mais sans valeur limite d’émission. Cette obligation sera mise en œuvre progressivement jusqu’en 2028, et n’inclut pas les rejets solides.
Autrement dit, la réglementation commence à réagir face à l’ampleur des dangers générés par ces polluants, mais les retards de mise en œuvre, l’absence de seuils contraignants, et le manque de transparence limitent fortement son efficacité.
Une logique à inverser : prévention, sobriété, alternatives à l’incinération
L’idée selon laquelle « brûler fait disparaître » est une illusion dangereuse. Qu’il s’agisse des PFAS ou d’autres polluants issus du processus d’incinération (dioxines et furanes, métaux lourds, particules fines, oxydes d’azote…), l’incinération disperse plutôt qu’elle ne détruit. Et ce sont les générations actuelles et futures qui en paient le prix, parfois de manière invisible, via l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, où les aliments que nous consommons.
La priorité doit être donnée à la réduction à la source, en amont de la production de déchets, conformément à la hiérarchie européenne des modes de traitement. Sortir de la logique du tout-jetable, repenser nos modes de production, de consommation, et limiter l’usage de substances polluantes sont des leviers essentiels pour enrayer durablement cette pollution invisible.
Zero Waste France appelle à un changement structurel. Tant que l’on continuera à brûler des déchets contenant des substances toxiques, on entretiendra une pollution chronique. Réduire les émissions suppose de réduire la production de déchets en amont, en particulier ceux contenant des substances dangereuses.
Nos demandes
- Bannir l’ensemble des PFAS dans les produits de consommation courante, sans exception sectorielle ;
- Renoncer à l’incinération comme méthode principale de traitement, au profit de filières réellement durables : prévention, réemploi, réparation, compostage, recyclage matière ;
- Mettre en place un suivi en temps réel et indépendant des émissions autour des incinérateurs, avec publication publique des données ;
- Instaurer des distances minimales entre incinérateurs et lieux sensibles (écoles, hôpitaux, zones d’habitation dense).
Sources :
[1] Arrêté du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles
[2] INERIS, Que sait-on sur les émissions de dioxines et furanes bromés ? octobre 2020
[3] Fiche de synthèse sur les risques sanitaires liés à l’incinération des déchets, Docteur Philippe RICHARD
[4] OMS, Dioxines, 29 novembre 2023
[5] L’internaute, Villes les plus pauvres de France : le classement, 2022
[6] ARS, Contamination des œufs de poules par des polluants organiques persistants, 2023
[7] ToxicoWatch, The True Toxic Toll – Biomonitoring report in Paris, France, 2025
[8] ANSES, PFAS : des substances chimiques très persistantes, avril 2024
[9] INRS, Acide perfluorooctanesulfonique (PFOS) et ses sels, avril 2023
[10] INERIS, Etude bibliographique sur la thermodégradation des PFAS, décembre 2023
[11] GAIA, Zero Waste Europe, Retombées toxiques : les mâchefers d’incinération des déchets dans une économie circulaire, janvier 2022
[12] Economie.gouv, tout savoir sur l’interdiction progressive des PFAS, 2025
[13] L’Humanité, PFAS : les lobbys industriels, ces autres polluants éternels, avril 2024