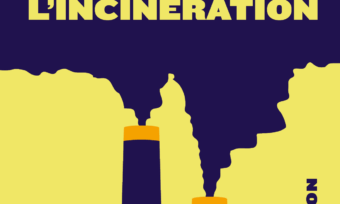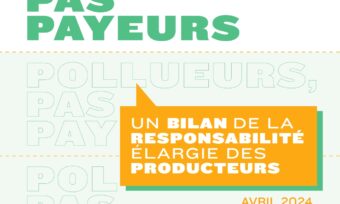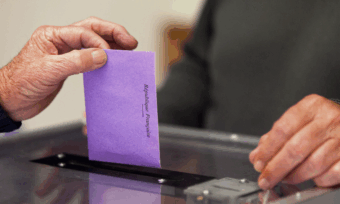Déchets textiles : une filière à bout de souffle face aux quantités mises sur le marché
Dans un contexte où le nombre de vêtements commercialisés en France atteint chaque année de nouveaux sommets, la filière des déchets textiles connaît une crise sans précédent, avec des tonnages qui s’accumulent sans pouvoir être traités. Face à cette saturation, les ONG appellent les pouvoirs publics à agir.
Une filière en crise
Depuis plusieurs mois, les opérateurs de collecte, de tri, de réemploi et de recyclage des textiles usagés, notamment les acteurs de l’économie sociale et solidaire (comme Le Relais, Emmaüs ou La croix rouge), font face à une saturation des stocks, qu’ils ne parviennent plus à écouler. Les bornes de dons textiles débordent sur la voirie ou sont parfois supprimées, laissant aux collectivités la coûteuse gestion des tonnages non collectés – qui finissent de fait, incinérés ou enfouis, sans aucune chance de seconde vie.
Cette saturation découle de plusieurs facteurs :
- D’un côté, la fermeture de certains débouchés liés à l’export de textiles en vue de réemploi ou réutilisation : jusqu’ici, il s’agissait d’un débouché clé pour la filière française. En 2022, Refashion estimait que 90% des 155 000 tonnes jugées aptes à la réutilisation étaient exportées [1], principalement vers l’Europe de l’Est et vers l’Afrique. La guerre en Ukraine a contribué à réduire drastiquement l’export en Europe de l’Ouest, tandis que le marché de la seconde main africain est concurrencé par le marché de l’ultra-fast-fashion et de la seconde main venue de Chine.
- De l’autre, la croissance sans précédent des mises en marché : selon le baromètre 2024 de Refashion [2], 3,5 milliards de pièces neuves ont été vendues en France en 2024 (vêtements, chaussures et linge de maison confondus), soit 10 millions chaque jour. Ce chiffre était de 2,5 milliards de pièces en 2014 [3], soit une augmentation de 40% des mises en marchés en dix ans.
Une telle crise a également révélé certaines fragilités de la filière, notamment en matière de modèle économique. La baisse de qualité du gisement collecté – qui s’explique à la fois par l’arrivée de plateformes de revente en ligne, où la “crème”, c’est-à-dire la partie du gisement qui a de la valeur, se revend directement, mais aussi par des vêtements de moins en moins bonne qualité, la plupart de temps en polyester -, affaiblit sa valeur de revente et fragilise les acteurs de la collecte et du tri, étapes pourtant essentielles pour permettre l’augmentation des tonnages réemployés, réutilisés ou recyclés. Pour autant, que le gisement soit ou non de qualité, les opérateurs de collecte et de tri doi vent le gérer en totalité.
En 2024 et en 2025, ces acteurs ont sollicité des aides exceptionnelles auprès de l’Etat et de l’éco-organisme de la filière TLC (textile, linge de maison, chaussures), Refashion. Malgré ces aides exceptionnelles (15 millions d’euros en 2025, qui ne couvrent toutefois pas l’intégralité des besoins), l’ensemble des acteurs s’accordent sur la nécessité de revoir le fonctionnement de la filière – avec toutefois des visions très différentes.
La refonte du cahier des charges de la filière
C’est dans un tel contexte que le gouvernement a lancé prématurément la refonte du cahier des charges de la filière TLC, alors que le cahier des charges actuel courait sur la période 2022-2027. L’objectif : repenser le fonctionnement opérationnel de la filière pour une mise en œuvre début 2026. Une concertation des parties prenantes, dont fait partie Zero Waste France, a débuté fin mai 2025.
Cahier des charges, filière REP : de quoi parle-t-on ?
Les filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) constituent une forme d’application du principe pollueur-payeur : les producteurs, c’est-à-dire les personnes qui mettent sur le marché certains produits, sont rendus responsables du financement ou de l’organisation de la prévention et de la gestion des déchets issus de ces produits en fin de vie [4]. Les metteurs en marchés versent ainsi aux éco-organismes des contributions, qui peuvent être modulées avec des primes et/ou des pénalités, selon des critères environnementaux incitatifs liés à l’éco-conception des produits.
Les metteurs en marché passent le plus souvent par la création de structures collectives (éco-organismes) pour la prévention et la gestion des déchets issus de leurs produits. Il existe deux modèles type de financement des opérations dans les filières REP :
- Modèle contributif ou financier : les éco-organismes récoltent les éco-contributions auprès des producteurs et les redistribuent aux collectivités territoriales ou à d’autres opérateurs qui assurent la collecte et le tri de ces déchets.
- Modèle opérationnel : l’éco-organisme récolte les éco-contributions et utilise ces fonds pour contractualiser lui-même avec des prestataires qui assurent la collecte et le traitement des déchets.
Les éco-organismes doivent répondre aux objectifs fixés par le cahier des charges des éco-organismes de la filière REP des produits qui le concerne : objectifs d’éco-conception, de collecte, de recyclage, et lorsque pertinent, de réemploi et de réparation. C’est l’Etat qui fixe ces objectifs et définit par arrêté le cahier des charges de chaque filière. Les éco-organismes ne satisfaisant pas à leurs obligations risquent des sanctions, principalement des amendes.
Parmi les premières orientations présentées par le ministère de la Transition écologique aux parties prenantes, certaines propositions sont alarmantes :
- La priorité donnée avant tout au recyclage, à travers un scénario irréaliste, prévoyant de quasiment multiplier par trois d’ici 2028 les tonnages de textiles envoyés au recyclage. Ce scénario ne prend pas en compte les difficultés techniques auxquelles se heurte déjà la filière : l’impossible séparation de fibres en mélange, qui rend difficile le recyclage mécanique d’une partie du gisement, ou encore le manque de recul sur des technologies de recyclage chimique encore hasardeuses. Ce développement massif du recyclage va nécessiter de nombreux investissements, qui de fait ne bénéficieront pas au réemploi ou à la réparation des vêtements.
- La réorientation massive des déchets textiles vers l’incinération, sous forme de combustibles solides de récupération : afin de gérer la transition vers un nouveau modèle fondé sur le recyclage, le ministère prévoit de façon temporaire une multiplication par huit des tonnages envoyés à l’incinération, soit 30% des tonnages collectés en 2028. Au regard des impacts sanitaires et environnementaux de l’incinération, ce choix paraît dangereux. D’autant qu’une fois les investissements faits pour incinérer de tels tonnages, il s’agira de les rentabiliser sur plusieurs décennies, créant une dépendance énergétique aux déchets en totale contradiction avec les objectifs de réduction, de réemploi et de recyclage, et rendant la mesure bien plus que temporaire.
- L’opérationnalisation de l’éco-organisme : le ministère propose que Refashion pilote directement la filière avec un système de sous-traitance aux opérateurs de terrain, dont les acteurs de l’ESS, via des appels d’offres. Or, une telle mise en concurrence des opérateurs peut avoir des conséquences dramatiques pour les acteurs de l’ESS, comme on l’a vu avec les suppressions massives d’emplois dans la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) suite à l’opérationnalisation de l’éco-organisme Ecosystem [5].
- La réduction de l’enveloppe du Fonds réparation : l’enveloppe du Fonds réparation étant sous-utilisée, le ministère prévoit de réduire son montant – ce qui permet, de fait, de réorienter certains financements vers d’autres solutions, notamment le développement du recyclage. Il faut tout d’abord souligner que, pour respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets, un tel transfert de moyens (de la réparation au recyclage) ne devrait pas être possible et la priorité devrait aller à la réduction et donc à la réparation. Ensuite, plutôt que de diminuer l’enveloppe du fonds, il s’agirait plutôt de financer des mesures permettant de lever les freins à la réparation. L’Ademe estime que le seuil psychologique relatif au coût de réparation correspond à 30% de la valeur d’un produit neuf [6] : au-delà de ce seuil, la réparation est perçue comme trop coûteuse pour les consommateur.ices. Dans le secteur textile, où les produits neufs ont des coûts très bas, il s’agirait d’augmenter le montant du bonus réparation, pour que le reste à charge soit plus compétitif qu’un achat neuf.
Une priorité : réduire la surproduction de vêtements
La question de la surproduction est la grande absente des propositions faites par le ministère dans le cadre de la refonte du cahier des charges. Alors que ces propositions se limitent à promouvoir des solutions de traitement de déchets dont les bénéfices environnementaux et la réelle efficacité sont encore à démontrer, la priorité devrait plutôt être donnée aux mesures limitant les flux de textiles mis sur le marché chaque année.
Seules des mesures déjà en cours de débat dans la proposition de loi contre la fast-fashion sont évoquées, notamment de nouvelles modulations fondées sur la durabilité extrinsèque des vêtements, c’est-à-dire les facteurs externes pouvant amener les consommateur.ices à arrêter de porter un vêtement (pratiques commerciales de renouvellement de gamme, d’incitation ou non à la réparation…). Or, pour réduire l’impact environnemental du secteur et augmenter le taux de collecte des déchets textiles, il est impératif d’adopter le plus rapidement possible un objectif de réduction des quantités de vêtements commercialisés d’ici 2030, et de l’inscrire noir sur blanc dans le cahier des charges de la filière.
Sans de tels objectifs, les scénarios proposés par le ministère – fondés sur des tonnages constants de mises en marché dans les années à venir – sont de fait rendus caduque : comment atteindre des objectifs de 60% de collecte des textiles usagés sans prendre en compte l’augmentation des quantités de textiles mis sur le marché chaque année ?
Découvrir nos demandesUne nécessaire réforme de la gouvernance des REP
De manière générale, pour que les filières REP deviennent un réel outil de prévention des déchets et fixent des trajectoires de réduction des mises en marché, il est nécessaire de repenser leur gouvernance. A l’heure actuelle, ce sont les metteurs en marché (ici, enseignes textiles et fédérations de commerce) qui siègent au conseil d’administration de l’éco-organisme Refashion, et de fait qui définissent les barèmes des éco-contributions et pilotent les fonds réemploi et réparation. Comment parvenir à faire primer le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets – où la prévention des déchets va de pair avec la limitation de la quantité de produits mis sur le marché – au sein d’un système piloté par des acteurs privés guidés par des intérêts économiques ?
Cette situation de conflits d’intérêts a été mise en évidence dans plusieurs rapports officiels : en juin 2024 dans le rapport conjoint de l’inspection générale des finances (IGF), de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) et du Conseil général de l’économie (CGE) [7], puis en juin 2025 dans le rapport des sénateur.ices Jacques Fernique et Marta de Cidrac [8]. Ces rapports pointent du doigt la nécessité de confier le pilotage des fonds réemploi / réparation, ainsi que la définition des barèmes des éco-contributions et la communication grand public à une structure tierce, dont les administrateurs et décisionnaires ne sont pas des metteurs en marché.
Au-delà de ce chantier, dont Zero Waste France attend la mise en œuvre, il est également indispensable d’acter que d’autres politiques publiques complémentaires doivent être déployées pour atteindre les objectifs de réduction des déchets. Au vu des débats actuels lors de la refonte du cahier des charges de la filière TLC, l’outil législatif demeure nécessaire pour fixer des trajectoires globales de prévention des déchets et de réduction des mises en marché sur toutes les filières ; mais aussi pour adopter des mesures fiscales à même d’intégrer les coûts environnementaux dans le signal prix des produits polluants et à usage unique ; et enfin, pour décider de mesures d’interdiction des matières non recyclables et/ou nocives pour la santé.
[1] Rapport d’activité Refashion 2022
[2] Baromètre annuel de la consommation des textiles et des chaussures en France en 2024, Refashion, juin 2025
[3] Rapport d’activité Eco-TLC 2015
[4] Cadre général des filières à responsabilité élargie des producteurs, ministère de la Transition écologique, 2017
[5] “Économie circulaire : 1.000 emplois menacés dans le réseau Envie suite au dernier appel d’offres d’Ecosystem”, article d’Emilie Zapalski pour Localtis, avril 2025, site de La banque des territoires
[6] Perception et pratiques des Français en matière de réparation en 2024, Ademe, avril 2025
[7] Performances et gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur, IGEDD, IGF, CGE, juin 2024
[8] Rapport d’information sur l’application de la loi Agec, Marta de Cidrac, Jacques Fernique, 25 juin 2025.