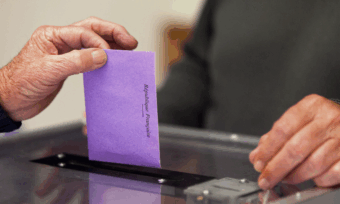Face au désengagement de l’Etat, financer la transition écologique des territoires
Le projet de loi de finances 2026 met en évidence le désengagement de l’Etat vis-à-vis du financement de la transition écologique, notamment au niveau local. Les annonces concernant la baisse supplémentaire du Fonds Vert pour 2026, principale source de financement de la prévention des déchets au niveau local, sont inquiétantes.
Budget 2026 et réduction drastique du Fonds Vert
Le projet de loi de finances (PLF) 2026 présenté par Sébastien Lecornu, prévoit le maintien du Fonds Vert, à un niveau qui n’a toutefois jamais été aussi bas : 650 millions d’euros pour financer la transition écologique sur les territoires. Alors que le Fonds vert a financé entre 2023 et 2024 3,6 milliards d’euros d’investissements, son enveloppe a déjà été divisée par deux entre 2024 et 2025, passant de 2,5 à 1,15 milliard d’euros, et devrait donc être quasiment à nouveau divisée par deux en 2026.
Alors que les obligations des collectivités en matière de transition écologique, et notamment de prévention des déchets, augmentent, ce désengagement financier de l’État pèse chaque année davantage sur la fiscalité locale. Et ce sont les contribuables qui paient la facture.
Cette carence et ses conséquences en termes de prévention ou de tri des déchets ont d’ailleurs des répercussions bien au-delà de l’échelon local : face à la non-atteinte de ses objectifs de recyclage, la France a dû régler en 2023 une amende d’1,5 milliard d’euros à l’Union européenne au titre de la “contribution plastique”. [1]
Des dépenses publiques encore massivement orientées vers la collecte et le traitement
En France, la gestion des déchets représente un coût considérable pour les finances publiques : 13,4 milliards d’euros en 2022 [2] dédiés au service public de gestion des déchets (SPGD), soit plus du double de ce qui était dépensé 20 ans plus tôt.
D’après l’Ademe [3], la répartition de ces dépenses est révélatrice des priorités actuelles :
- 39 % sont consacrés au traitement (incinération, enfouissement),
- 59 % à la collecte et aux services associés (transport, collecte, pré-collecte, structure),
- seulement 1 % à la prévention,
- et 1 % à la communication.
Cette situation s’inscrit dans une tendance structurelle : depuis plusieurs années, la quantité de déchets produits en France ne cesse d’augmenter, en témoigne l’évolution du ratio global de DMA (y compris gravats), passé de 573 kg/hab/an à 609 kg/hab/an entre 2013 et 2021, entraînant mécaniquement une hausse continue des coûts liés à leur collecte et à leur traitement. Entre 2000 et 2022, ces dépenses sont ainsi passées de 9,4 milliards d’euros à 21,6 milliards d’euros. [4]
Autrement dit, l’essentiel des financements est encore orienté vers la fin de chaîne, alors même que la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC), adoptée en 2020, a fixé un objectif clair : réduire de 15 % la production de déchets par habitant d’ici 2030, par rapport au niveau de 2010. En parallèle, la directive européenne sur l’économie circulaire, transposée en droit français la même année, impose de limiter à 10 % d’ici 2035 la proportion de déchets ménagers envoyés en stockage.
Pourtant, les choix d’investissement des collectivités restent en décalage avec ces orientations. En 2020, l’incinération a coûté 1,7 milliard d’euros pour brûler 14,5 millions de tonnes de déchets. Or, la construction de chaque nouvel incinérateur engage les finances publiques sur une durée de 40 à 50 ans, alors même que la loi établit une hiérarchie des modes de traitement où la prévention doit être prioritaire.
Si la hausse de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) — portée à 65 € la tonne pour l’enfouissement et 25 € pour l’incinération — a permis de réduire les tonnages envoyés en décharge, elle a aussi entraîné un effet de report des flux de l’enfouissement vers l’incinération. Ce déplacement a conduit plusieurs collectivités à justifier la construction de nouvelles unités de valorisation énergétique ou l’agrandissement d’installations existantes, des projets très coûteux qui engagent les territoires pour plusieurs décennies. Ces infrastructures doivent ensuite être “alimentées” (en déchets) en continu pour être rentabilisées, ce qui enferme les collectivités dans un modèle fondé sur des volumes élevés de déchets — à rebours de l’objectif de prévention et de réduction inscrit dans la hiérarchie des modes de traitement.
Tant que les budgets continueront à privilégier l’incinération et l’enfouissement, les collectivités resteront enfermées dans un modèle coûteux et contraire à la transition écologique.
Quand le contribuable compense le désengagement de l’État
En théorie, le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) doit rester proportionné aux dépenses réelles du service, la jurisprudence du Conseil d’État estime qu’un excédent allant jusqu’à environ 15 % peut rester tolérable, au-delà duquel la taxe peut être jugée manifestement disproportionnée. [5] Pourtant, comme l’a révélé une enquête du journal Le Monde [6], certaines collectivités fixent depuis quelques années des niveaux bien supérieurs, non pas par excès de zèle, mais pour couvrir leurs dépenses de collecte et de traitement des déchets, faute de financements nationaux suffisants pour l’investissement. Cette situation traduit un déséquilibre structurel : l’État n’assume pas son rôle de financeur des investissements nécessaires à la transition écologique, et ce sont les habitants qui compensent à travers une fiscalité locale en constante augmentation.
Les conséquences sont déjà visibles : le tri à la source des biodéchets, pourtant obligatoire depuis le 1er janvier 2024, n’est toujours pas généralisé (seulement 50 % de couverture au 1er janvier 2025 selon l’Ademe) notamment en raison du manque de moyens de certaines collectivités pour équiper leurs territoires. La situation s’est aggravée par la baisse drastique du Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires — dit « Fonds Vert » — dont l’enveloppe a été divisée par deux entre 2024 et 2025, passant de 2,5 à 1,2 milliard d’euros, et qui risque de disparaître dès 2026. [7]
Ces réductions budgétaires ont des conséquences concrètes sur les investissements que les collectivités sont légalement tenues de réaliser pour répondre à leurs obligations. La question est d’autant plus cruciale à l’approche des élections municipales de 2026, qui marqueront le début d’un nouveau cycle d’investissement local.
Concrètement, plusieurs obligations prévues par la loi restent largement inabouties faute de moyens : les fontaines à eau, pourtant obligatoires depuis janvier 2022 dans les établissements recevant plus de 300 personnes et dont les collectivités sont responsables, ne sont toujours pas généralisées sur l’intégralité des ERP (établissement recevant du public). De même, les poubelles de tri, rendues obligatoires par la loi AGEC depuis le 1er janvier 2025 dans les espaces publics, restent encore trop largement absentes. Enfin, la loi EGALIM impose l’intégration de contenants réutilisables dans les cuisines centrales de restauration collective depuis 2025, mais les investissements dans le réemploi demeurent marginaux, insuffisants et peu contrôlés, y compris dans les cantines scolaires. Autant de retards qui freinent concrètement la transition écologique locale et accentuent le sentiment d’un transfert de charges vers les contribuables.
La responsabilité élargie des producteurs (REP) : un angle mort persistant
Au-delà de la fiscalité locale, le système de responsabilité élargie des producteurs (REP) doit être interrogé. Ce dispositif, qui attribue aux metteurs sur le marché la charge financière ou organisationnelle de la gestion des déchets issus de leurs produits, ne couvre aujourd’hui qu’une partie des coûts réels supportés par les collectivités. En pratique, celles-ci — et donc les contribuables — continuent d’assumer une large part du financement de la fin de vie des produits.
De manière générale, pour que les filières REP deviennent un véritable levier de prévention des déchets et fixent des trajectoires de réduction des mises sur le marché, il est indispensable d’en repenser la gouvernance. Aujourd’hui, les metteurs en marché siègent majoritairement aux conseils d’administration des éco-organismes et définissent ainsi les barèmes d’éco-contribution, tout en pilotant les fonds dédiés au réemploi et à la réparation. Comment garantir la primauté de la prévention et du respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets, lorsque le système reste dirigé par des acteurs privés dont les intérêts économiques peuvent entrer en contradiction avec ces objectifs ?
L’exemple de la filière des emballages illustre bien cette situation
- La REP emballages couvre aujourd’hui seulement 40 % des coûts réels de gestion des déchets [8],
- Elle ne contraint pas suffisamment les industriels à l’écoconception, ou à ne pas utiliser de matériaux non recyclables,
- Les volumes d’emballages continuent à croître (en 2021, les pays de l’UE ont généré 84 millions de tonnes de déchets d’emballages, soit 24 % de plus qu’en 2010 [9]).
Malgré la REP, les éco-organismes ne compensent pas l’ensemble des coûts de collecte, de tri et de traitement, laissant un reste à charge important pour les collectivités.
Le problème dépasse d’ailleurs cette seule filière. Dans le textile, la crise du modèle actuel a entraîné la suppression ou la saturation de nombreuses boîtes à dons, dont les déchets abandonnés se retrouvent in fine gérés par les services publics locaux. Ces coûts, non pris en charge par les producteurs, pèsent directement sur les budgets municipaux.
En réalité, ce sont encore les ménages (33 %) et les administrations publiques (25 %) [10] qui ensemble supportent la majeure partie des coûts, alors même que les producteurs décident de la mise sur le marché de produits générateurs de déchets : emballages jetables à usage unique, textiles non recyclables ou équipements électroniques à faible durée de vie, entre autres choses.
Cette sous-responsabilisation des producteurs explique en partie pourquoi les collectivités doivent compenser par la TEOM ou la REOM, alimentant un fort sentiment d’injustice chez les citoyen·nes. Une réforme s’impose pour rétablir une équité financière et faire en sorte que les producteurs assument pleinement leurs responsabilités.
Nos demandes pour une fiscalité des déchets plus juste et tournée vers l’avenir
Face à l’instabilité politique actuelle, Zero Waste France appelle à une réforme profonde de la fiscalité des déchets, articulée autour de trois axes :
Aligner les budgets publics avec la hiérarchie des modes de traitement
A l’occasion des élections municipales en mars prochain, ce seront des milliers d’exécutifs locaux qui pourront décider de lancer des opérations structurantes pour la transition écologique. Dans ce contexte, il est indispensable que l’État :
- Maintienne le Fonds Vert destiné au financement de la transition écologique sur les territoires, et lui affecte des montants conséquents dédiés au financement de la prévention des déchets en premier lieu, puis à leur réemploi, réutilisation et recyclage ;
- Préserve l’autofinancement des collectivités et leur donne de la visibilité sur leurs ressources ;
- Veille, dans le cadre du PLF 2026, à ce que la contribution des collectivités à la réduction des déficits publics ne se traduise pas par un frein à l’investissement local ;
- Poursuivre la trajectoire de hausse de la TGAP sur l’enfouissement entre 2026 et 2030 pour offrir de la visibilité aux acteurs et inciter à la réduction des tonnages enfouis, tout en relevant progressivement la TGAP sur l’incinération afin de rapprocher son niveau de celui de l’enfouissement (65 €/t en 2025) et d’éviter un déséquilibre entre les deux modes de traitement.
Développer la tarification incitative (TI)
Encourager les collectivités à orienter progressivement la TEOM ou la REOM classique vers des dispositifs incitatifs, intégrant une modulation sociale, afin que chacun paie en fonction de ce qu’il jette réellement tout en prenant en compte les critères sociaux (revenus, composition du foyer…).
La tarification incitative (TI), qu’elle s’applique à la TEOM (TEOMi) ou à la REOM (REOMi), constitue un levier puissant pour réduire la production de déchets et appliquer concrètement le principe du « pollueur-payeur ». Elle repose sur une part fixe (selon la valeur locative ou un forfait par foyer) et une part variable liée à la quantité de déchets produits, mesurée selon le volume du bac, le nombre de levées ou le poids collecté.
Les résultats observés dans les territoires ayant mis en place la tarification incitative sont particulièrement encourageants : une réduction moyenne de 30 à 40 % des déchets résiduels, une hausse significative du tri des matériaux recyclables et des biodéchets, une plus grande équité puisque chacun·e paie en fonction de sa production réelle, et enfin une stabilisation, voire une baisse des coûts, rendue possible par la diminution des tonnages incinérés ou enfouis.
Il est donc nécessaire :
- D’accélérer la généralisation de la tarification incitative sur le territoire, en accompagnant techniquement et financièrement les collectivités dans la transition ;
- De conditionner une partie des aides du Fonds Vert ou des dispositifs nationaux de soutien à la prévention des déchets à la mise en place d’une démarche de TI ;
- Intégrer une modulation sociale, pour garantir l’équité du dispositif et éviter toute charge disproportionnée pour les ménages modestes ;
- Améliorer le suivi et la transparence des données sur la production de déchets, afin de mieux évaluer l’efficacité de la tarification incitative dans le temps.
Taxer les éco-organismes qui n’atteignent pas leurs objectifs
Il est indispensable que l’État fasse contribuer les éco-organismes au coût de gestion des déchets non collectés, non triés, non réemployés ou non recyclés, alors que concernés par une filière de responsabilité élargie des producteurs (REP), via une taxe calculée sur l’écart des résultats des éco-organismes aux objectifs prévus dans le cahier des charges de leur filière.
La fiscalité des déchets n’est pas qu’une question technique mais un choix politique qui engage nos territoires sur plusieurs décennies. Aujourd’hui, les citoyen·es paient un impôt opaque, qui sert trop souvent à financer des solutions coûteuses et contraires à la hiérarchie des modes de traitement.
Nous devons inverser la logique : faire de la fiscalité des déchets un levier de transition écologique et de justice sociale, plutôt qu’un impôt caché qui entretient le modèle du tout-incinération.
[1] Novethic, Taxe plastique : la France doit payer 1,5 milliard d’euros à l’Europe, et ce n’est pas la première fois, août 2024
[2] Ministère de la transition écologique, la dépense de gestion des déchets en 2022, avril 2025
[3] Ademe, Référentiel des coûts du service public de gestion des déchets en France métropolitaine données 2022, janvier 2025
[4] SDES, La dépense de gestion des déchets en 2022, avril 2025
[5] Le Conseil d’État a jugé, dans l’arrêt Société Auchan France en date du 31 mars 2014, que la TEOM “ne doit pas financer un excédent manifeste (pas plus de 15 %)” par rapport au coût du service public de gestion des déchets ménagers.
[6] Le Monde, Taxe sur les déchets : pourquoi certains contribuables paient plus que nécessaire, août 2025
[7] Projet de loi de finances pour 2025 : Écologie, développement et mobilité durables
[8] Ministère de la transition écologique, la dépense de gestion des déchets en 2022, avril 2025
[9] Ministère de la transition écologique, la dépense de gestion des déchets en 2022, avril 2025
[10] Conseil Européen, emballages